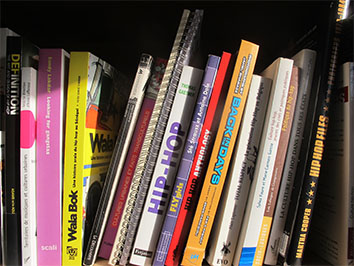
Ce centre de doc comporte des livres, articles de presse, films de fiction et documentaires, cds de rap belge, mémoires d’étudiants… Vous pouvez découvrir cette matière en explorant notre catalogue ci-dessous.
Attention, celui-ci n’est pas exhaustif, le processus d’encodage des documents étant continu. Donc n’hésitez pas à venir fouiller directement dans nos rayons, vous y ferez encore d’autres découvertes !
 Accueil
Accueil
A partir de cette page vous pouvez :
category
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
Catégories


 Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche« Ce n’est pas le hip-hop qui nous fait voyager, c’est nous qui faisons voyager le hip- hop » [Thèse] / Cécile Navarro

Titre : « Ce n’est pas le hip-hop qui nous fait voyager, c’est nous qui faisons voyager le hip- hop » [Thèse] : Représentations et pratiques d’ (im)mobilités au sein d’une scène musicale translocale au Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Navarro Importance : 457 p. Catégories : A:Afrique
E:Ethnographie
G:Globalisation
I:Identité
M:Migration
M:Mobilité sociale
M:Mobilité spatiale
P:Politique
P:Politique culturelle
R:Rap
R:Rap (Afrique)
R:Rap (Sénégal)
S
S:Scène
S:Sénégal
T
T:TranslocalitéRésumé : A l’aune de la célébration des 30 ans du « Rap Galsen », nom communément donné au rap au Sénégal (1988-2018), ce travail interroge les dynamiques de sa production du point de vue des (im)mobilités de différents acteur.trice.s (artistes, producteurs, promoteurs). Ce parti-pris, ancré dans les études sur le transnational et le « mobility turn », propose de renouveler l’approche des pratiques musicales en globalisation tout en revisitant les sciences sociales des migrations au prisme des pratiques artistiques. A l’aide du concept de « scène », le rap galsen est abordé au travers des répertoires d’action et de discours utilisés pour définir son existence, faisant appel aux catégories de « local » et « global », dans le cadre d’établissement de frontières entre « nous » et « eux ». L’ancrage « local » du rap sénégalais est ainsi exploré à l’aune de processus d’authentification de ce que signifie être « Sénégalais » tout en faisant du rap.
Comment ces revendications locales s’accommodent-elles des mobilités croissantes de certains artistes de rap sénégalais et des désirs d’« exportation » de nombreux autres ?
Ce travail montre comment les dynamiques d’(im)mobilités s’enchâssent au cœur de rapports de pouvoir, entre ceux qui cherchent à imposer une certaine définition du rap galsen et ceux qui cherchent à s’en défaire. La prise en compte de la diversité des (im)mobilités impliquées (mobilités circulatoires, « en étoile », pendulaires, migrations, migrations de retour, immobilités) dans la pratique artistique permet d’envisager comment chaque forme de mobilité impacte les positionnements des acteurs (im)mobiles sur la scène, et leur capacité à peser sur les processus de définition du « rap galsen ». Dakar, Paris, Berlin, Munich, Lausanne, Genève, Baltimore, New York et Washington, tels sont les lieux visités au cours de ce travail pour suivre ou rencontrer des acteur.trice.s de la scène rap sénégalaise, tissant les liens entre plusieurs localités au-delà des frontières nationales, dessinant les contours d’une « scène musicale translocale ».En ligne : https://www.researchgate.net/publication/339843062_Ce_n%27est_pas_le_hip-hop_qui [...] Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9294 « Ce n’est pas le hip-hop qui nous fait voyager, c’est nous qui faisons voyager le hip- hop » [Thèse] : Représentations et pratiques d’ (im)mobilités au sein d’une scène musicale translocale au Sénégal [texte imprimé] / Cécile Navarro . - [s.d.] . - 457 p.
Catégories : A:Afrique
E:Ethnographie
G:Globalisation
I:Identité
M:Migration
M:Mobilité sociale
M:Mobilité spatiale
P:Politique
P:Politique culturelle
R:Rap
R:Rap (Afrique)
R:Rap (Sénégal)
S
S:Scène
S:Sénégal
T
T:TranslocalitéRésumé : A l’aune de la célébration des 30 ans du « Rap Galsen », nom communément donné au rap au Sénégal (1988-2018), ce travail interroge les dynamiques de sa production du point de vue des (im)mobilités de différents acteur.trice.s (artistes, producteurs, promoteurs). Ce parti-pris, ancré dans les études sur le transnational et le « mobility turn », propose de renouveler l’approche des pratiques musicales en globalisation tout en revisitant les sciences sociales des migrations au prisme des pratiques artistiques. A l’aide du concept de « scène », le rap galsen est abordé au travers des répertoires d’action et de discours utilisés pour définir son existence, faisant appel aux catégories de « local » et « global », dans le cadre d’établissement de frontières entre « nous » et « eux ». L’ancrage « local » du rap sénégalais est ainsi exploré à l’aune de processus d’authentification de ce que signifie être « Sénégalais » tout en faisant du rap.
Comment ces revendications locales s’accommodent-elles des mobilités croissantes de certains artistes de rap sénégalais et des désirs d’« exportation » de nombreux autres ?
Ce travail montre comment les dynamiques d’(im)mobilités s’enchâssent au cœur de rapports de pouvoir, entre ceux qui cherchent à imposer une certaine définition du rap galsen et ceux qui cherchent à s’en défaire. La prise en compte de la diversité des (im)mobilités impliquées (mobilités circulatoires, « en étoile », pendulaires, migrations, migrations de retour, immobilités) dans la pratique artistique permet d’envisager comment chaque forme de mobilité impacte les positionnements des acteurs (im)mobiles sur la scène, et leur capacité à peser sur les processus de définition du « rap galsen ». Dakar, Paris, Berlin, Munich, Lausanne, Genève, Baltimore, New York et Washington, tels sont les lieux visités au cours de ce travail pour suivre ou rencontrer des acteur.trice.s de la scène rap sénégalaise, tissant les liens entre plusieurs localités au-delà des frontières nationales, dessinant les contours d’une « scène musicale translocale ».En ligne : https://www.researchgate.net/publication/339843062_Ce_n%27est_pas_le_hip-hop_qui [...] Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9294 Exemplaires
Support Localisation Section DisponibilitĂ© Catalogue Biblio Saint-Gilles Article Centre de doc. Mémoires et dossiers Exclu du prĂŞt
Titre : Composer sur son ordinateur : Les pratiques musicales en amateur liées à l’informatique (Rapport) Type de document : texte imprimé Auteurs : Serge Pouts-Lajus Année de publication : 2002 Importance : 65 p. Langues : Français Langues originales : Français Catégories : A:Apprentissage technique
D:Dispositif
E:Ethnographie
I:Ingénierie du son
M:Matériel son
R:Rap
R:Rap et Technologie
R:réseaux sociauxRésumé : Le développement des nouvelles technologies, plus particulièrement liées à l’informatique, en bouleversant les possibilités d’accès au monde sonore quelles que soient ses formes, interroge de façon pressante les pouvoirs publics sur la pertinence de leurs politiques en direction des pratiques musicales en général, et de l’accompagnement de celles des amateurs, en particulier.
En effet, l’abaissement des coûts d’équipement, la simplification des systèmes, leur performance et la possibilité d’y accéder à partir d’un matériel personnel élémentaire, ainsi que tous les dispositifs de connexion et de mise en réseau, offrent aujourd’hui un potentiel jamais connu d’approche directe d’un univers musical et de processus réservés jusque là aux seuls initiés.
La pratique musicale s’en trouve de fait affectée dans son approche – modes, publics, etc. – et surtout dans sa dimension la plus créative et ludique, créant ainsi de nouvelles situations et de nouveaux besoins.
Soucieuse d’anticiper la demande sociale dans ce domaine, et de mieux travailler à l’évolution des dispositifs d’enseignement, de formation et de suivi des pratiques, la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles du Ministère de la Culture et de la Communication a donc sollicité le Département des Etudes et de la Prospective pour un premier chantier de description de profils de musiciens engagés dans cette utilisation de l’informatique.
Le but de l’étude était donc de dégager un tableau des différents types d’amateurs, des matériels utilisés par ceux-ci, de la diversité, voire de la nouveauté des pratiques, et des contextes de celles-ci.
L’interrogation des praticiens sur leurs besoins en termes d’accompagnement, de gestion du matériel, de lieux de rencontre, de formation musicale ou encore d’information, était également demandée pour une première mise en perspective des politiques actuelles en direction de ces amateurs.En ligne : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publication [...] Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9296 Composer sur son ordinateur : Les pratiques musicales en amateur liées à l’informatique (Rapport) [texte imprimé] / Serge Pouts-Lajus . - 2002 . - 65 p.
Langues : Français Langues originales : Français
Catégories : A:Apprentissage technique
D:Dispositif
E:Ethnographie
I:Ingénierie du son
M:Matériel son
R:Rap
R:Rap et Technologie
R:réseaux sociauxRésumé : Le développement des nouvelles technologies, plus particulièrement liées à l’informatique, en bouleversant les possibilités d’accès au monde sonore quelles que soient ses formes, interroge de façon pressante les pouvoirs publics sur la pertinence de leurs politiques en direction des pratiques musicales en général, et de l’accompagnement de celles des amateurs, en particulier.
En effet, l’abaissement des coûts d’équipement, la simplification des systèmes, leur performance et la possibilité d’y accéder à partir d’un matériel personnel élémentaire, ainsi que tous les dispositifs de connexion et de mise en réseau, offrent aujourd’hui un potentiel jamais connu d’approche directe d’un univers musical et de processus réservés jusque là aux seuls initiés.
La pratique musicale s’en trouve de fait affectée dans son approche – modes, publics, etc. – et surtout dans sa dimension la plus créative et ludique, créant ainsi de nouvelles situations et de nouveaux besoins.
Soucieuse d’anticiper la demande sociale dans ce domaine, et de mieux travailler à l’évolution des dispositifs d’enseignement, de formation et de suivi des pratiques, la Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles du Ministère de la Culture et de la Communication a donc sollicité le Département des Etudes et de la Prospective pour un premier chantier de description de profils de musiciens engagés dans cette utilisation de l’informatique.
Le but de l’étude était donc de dégager un tableau des différents types d’amateurs, des matériels utilisés par ceux-ci, de la diversité, voire de la nouveauté des pratiques, et des contextes de celles-ci.
L’interrogation des praticiens sur leurs besoins en termes d’accompagnement, de gestion du matériel, de lieux de rencontre, de formation musicale ou encore d’information, était également demandée pour une première mise en perspective des politiques actuelles en direction de ces amateurs.En ligne : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publication [...] Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9296 Exemplaires
Support Localisation Section DisponibilitĂ© Catalogue Biblio Saint-Gilles Article Centre de doc. Mémoires et dossiers Exclu du prĂŞt
Titre : «Devenir rappeur engagé» : L’émergence controversée du rap dans l’espace public camerounais Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Awondo ; Jean-Marcellin Manga Année de publication : 2016 Langues : Français Langues originales : Français Catégories : C:Cameroun
C:Critique
C:rap (Cameroun)
E:Engagement
E:Espace public
E:Ethnographie
P:Politique
P:Politique culturelle
R:Rap
R:Rap (Afrique)
S:socio-politiqueRésumé : Cet article tente d’apporter une intelligibilité du rap camerounais à partir d’une double lecture: d’une part, en interrogeant son historicité au Cameroun, c’est-à -dire son émergence et son enracinement dans le milieu artistique et culturel, d’autre part, en suivant les rappeurs eux-mêmes ainsi qu’une partie de la critique médiatique dans l’analyse qu’ils font du rap. En privilégiant cette entrée, deux faits majeurs retiennent l’attention : d’abord, une forte mise en concurrence du rap dès son arrivée dans l’espace camerounais avec d’autres styles musicaux. Cette concurrence fut forte, y compris sur la dimension d’engagement critique attendue comme un trait identitaire du rap, l’obligeant ainsi à se légitimer tout en cherchant une identité. Ensuite, les rappeurs camerounais font face à un double procès ; l’un, de la part d’une opinion médiatique soupçonnant leurs accointances avec des autorités au pouvoir vues comme corrompues ; l’autre, de la part desdites autorités frileuses vis-à -vis de la parole critique dans l’espace public. En ligne : https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2016-1-page-123.htm Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9292 «Devenir rappeur engagé» : L’émergence controversée du rap dans l’espace public camerounais [texte imprimé] / Patrick Awondo ; Jean-Marcellin Manga . - 2016.
Langues : Français Langues originales : Français
Catégories : C:Cameroun
C:Critique
C:rap (Cameroun)
E:Engagement
E:Espace public
E:Ethnographie
P:Politique
P:Politique culturelle
R:Rap
R:Rap (Afrique)
S:socio-politiqueRésumé : Cet article tente d’apporter une intelligibilité du rap camerounais à partir d’une double lecture: d’une part, en interrogeant son historicité au Cameroun, c’est-à -dire son émergence et son enracinement dans le milieu artistique et culturel, d’autre part, en suivant les rappeurs eux-mêmes ainsi qu’une partie de la critique médiatique dans l’analyse qu’ils font du rap. En privilégiant cette entrée, deux faits majeurs retiennent l’attention : d’abord, une forte mise en concurrence du rap dès son arrivée dans l’espace camerounais avec d’autres styles musicaux. Cette concurrence fut forte, y compris sur la dimension d’engagement critique attendue comme un trait identitaire du rap, l’obligeant ainsi à se légitimer tout en cherchant une identité. Ensuite, les rappeurs camerounais font face à un double procès ; l’un, de la part d’une opinion médiatique soupçonnant leurs accointances avec des autorités au pouvoir vues comme corrompues ; l’autre, de la part desdites autorités frileuses vis-à -vis de la parole critique dans l’espace public. En ligne : https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2016-1-page-123.htm Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9292 Exemplaires
Support Localisation Section Disponibilité Catalogue Biblio Saint-Gilles Article Centre de doc. Fardes Exclu du prêt Enquête sur la pratique du rap en français contemporain / Grégory Meuter / Université Catholique de Louvain-la-Neuve (2023)
Titre : Enquête sur la pratique du rap en français contemporain : Sémiotique de l'énonciation et compréhension politique Type de document : texte imprimé Auteurs : Grégory Meuter, Auteur Editeur : Université Catholique de Louvain-la-Neuve Année de publication : 2023 Langues : Français Catégories : A:Analyse de la musique
A:Analyse du hip-hop
A:Analyse du rap
E:Ethnographie
P:Philosophie du hip hop
Philosophie de la culture
Philosophie politique
R:Rap et philosophie
S:Socio-linguistique
S:socio-politique
S:Sociologie
S:Sociologie de la culture
S:Sociologie de la musique
S:Sociologie du hip-hop
S:Sociologie du rapRésumé : Grâce à une approche pragmatiste de l'enquête, j'ai approché le monde semi-professionnel du rap belge Carole et bruxellois. Lors d'une intervention en tant que sociologue, j'ai rencontré une problématique quant à la teneur politique politique du rap en français. L'intrigue débuta par des lectures à propos du lien entre musiques populaires et politique. Dirigé vers une enquête ethnographique dans es studios d'enregistrement, c'est via la performance du rappeur que l'intrigue m'a dirigé vers la chanson en tant qu'objet investi socialement.
Par la distinction entre Le et La politique, ce mémoire propose de comprendre la chanson en soi, en tant que phénomène énonciatif, et son lien avec le domaine du politique.
Trois analyses sémiotiques serviront à illustrer la phénoménologie d'une énonciation de rap et des entretiens semi-directifs et évolutifs serviront à comprendre l'idée de calibrage sémiotique. Ces analyses permettront de comprendre le fondement du lien entre rap en français et domaine politique aujourd'hui.Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9498 Enquête sur la pratique du rap en français contemporain : Sémiotique de l'énonciation et compréhension politique [texte imprimé] / Grégory Meuter, Auteur . - [S.l.] : Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2023.
Langues : Français
Catégories : A:Analyse de la musique
A:Analyse du hip-hop
A:Analyse du rap
E:Ethnographie
P:Philosophie du hip hop
Philosophie de la culture
Philosophie politique
R:Rap et philosophie
S:Socio-linguistique
S:socio-politique
S:Sociologie
S:Sociologie de la culture
S:Sociologie de la musique
S:Sociologie du hip-hop
S:Sociologie du rapRésumé : Grâce à une approche pragmatiste de l'enquête, j'ai approché le monde semi-professionnel du rap belge Carole et bruxellois. Lors d'une intervention en tant que sociologue, j'ai rencontré une problématique quant à la teneur politique politique du rap en français. L'intrigue débuta par des lectures à propos du lien entre musiques populaires et politique. Dirigé vers une enquête ethnographique dans es studios d'enregistrement, c'est via la performance du rappeur que l'intrigue m'a dirigé vers la chanson en tant qu'objet investi socialement.
Par la distinction entre Le et La politique, ce mémoire propose de comprendre la chanson en soi, en tant que phénomène énonciatif, et son lien avec le domaine du politique.
Trois analyses sémiotiques serviront à illustrer la phénoménologie d'une énonciation de rap et des entretiens semi-directifs et évolutifs serviront à comprendre l'idée de calibrage sémiotique. Ces analyses permettront de comprendre le fondement du lien entre rap en français et domaine politique aujourd'hui.Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9498 Exemplaires
Support Localisation Section Disponibilité Catalogue Biblio Saint-Gilles Article Centre de doc. Fardes Exclu du prêt
Titre : Entre représentations et stratégies personnelles [mémoire] : Une ethnographie auprès de rappeurs à Ouagadougou (Burkina Faso) Type de document : texte imprimé Auteurs : Anna Cuomo Editeur : Paris [France] : EHESS Importance : 116 p. Langues : Français Langues originales : Français Catégories : A:Anthropologie
B:Burkina Faso
E:Ethnographie
H:Histoire du hip-hop
H:Histoire du rap
I:Identité
M:MĂ©moire
O:Ouagadougou
S:Socio-linguistique
S:socio-politiqueRésumé : Plusieurs voyages au Burkina Faso effectués depuis 2008 m’ont amenée à choisir la musique rap comme objet d’étude, grâce à la rencontre avec des artistes sur place. Etudiante en licence d’anthropologie à l’université de Bordeaux 2 en 2009, je me suis donc intéressée à cette pratique artistique et j’ai constaté qu’il n’existait pas encore de travaux sur le rap à Ouagadougou dans la discipline. Juste avant l’entrée en master 1 en novembre 2010, j’ai décidé de retourner au Burkina Faso pour une durée de six semaines afin d’effectuer une pré-enquête. J’avais pour objectifs de me familiariser avec le milieu du rap ouagalais, de rencontrer un maximum de rappeurs afin de constater l’ampleur du phénomène, de connaître ce réseau, et de suivre plusieurs groupes dans des émissions de radio, des répétitions, en concerts, lors de tournées dans d’autres villes du pays. Je souhaitais faire un « état des lieux » de ce que représente le rap à Ouagadougou et connaître son historique. De plus, je devais récupérer des morceaux de rap et me familiariser avec les albums des différents groupes. Après l’année de master 1 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris, j’ai effectué une enquête de terrain de 5 mois de juin à novembre 2011 à Ouagadougou.
Bien qu’il n’ait été que très peu étudié au Burkina Faso, le hip-hop a fait l’objet de nombreuses recherches, dans des domaines différents (sociologie, linguistique, anthropologie, musicologie, sciences politiques notamment) et sur de nombreux pays (Etats-Unis, France, Sénégal, Gabon, Tanzanie, Algérie, Liban, Brésil etc.). Ce phénomène semble donc intéresser de nombreux chercheurs, et a été étudié sous différents angles d’analyse : comme culture populaire urbaine, comme micro-espace, comme processus d’indigénisation d’un mouvement global, en lien avec le religieux et également comme prise de parole dans l’espace public par une jeunesse dominée.
En ligne : https://www.academia.edu/15093786/Entre_repr%C3%A9sentations_et_strat%C3%A9gies_ [...] Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9300 Entre représentations et stratégies personnelles [mémoire] : Une ethnographie auprès de rappeurs à Ouagadougou (Burkina Faso) [texte imprimé] / Anna Cuomo . - Paris (54 boulevard Raspail, 75006, France) : EHESS, [s.d.] . - 116 p.
Langues : Français Langues originales : Français
Catégories : A:Anthropologie
B:Burkina Faso
E:Ethnographie
H:Histoire du hip-hop
H:Histoire du rap
I:Identité
M:MĂ©moire
O:Ouagadougou
S:Socio-linguistique
S:socio-politiqueRésumé : Plusieurs voyages au Burkina Faso effectués depuis 2008 m’ont amenée à choisir la musique rap comme objet d’étude, grâce à la rencontre avec des artistes sur place. Etudiante en licence d’anthropologie à l’université de Bordeaux 2 en 2009, je me suis donc intéressée à cette pratique artistique et j’ai constaté qu’il n’existait pas encore de travaux sur le rap à Ouagadougou dans la discipline. Juste avant l’entrée en master 1 en novembre 2010, j’ai décidé de retourner au Burkina Faso pour une durée de six semaines afin d’effectuer une pré-enquête. J’avais pour objectifs de me familiariser avec le milieu du rap ouagalais, de rencontrer un maximum de rappeurs afin de constater l’ampleur du phénomène, de connaître ce réseau, et de suivre plusieurs groupes dans des émissions de radio, des répétitions, en concerts, lors de tournées dans d’autres villes du pays. Je souhaitais faire un « état des lieux » de ce que représente le rap à Ouagadougou et connaître son historique. De plus, je devais récupérer des morceaux de rap et me familiariser avec les albums des différents groupes. Après l’année de master 1 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris, j’ai effectué une enquête de terrain de 5 mois de juin à novembre 2011 à Ouagadougou.
Bien qu’il n’ait été que très peu étudié au Burkina Faso, le hip-hop a fait l’objet de nombreuses recherches, dans des domaines différents (sociologie, linguistique, anthropologie, musicologie, sciences politiques notamment) et sur de nombreux pays (Etats-Unis, France, Sénégal, Gabon, Tanzanie, Algérie, Liban, Brésil etc.). Ce phénomène semble donc intéresser de nombreux chercheurs, et a été étudié sous différents angles d’analyse : comme culture populaire urbaine, comme micro-espace, comme processus d’indigénisation d’un mouvement global, en lien avec le religieux et également comme prise de parole dans l’espace public par une jeunesse dominée.
En ligne : https://www.academia.edu/15093786/Entre_repr%C3%A9sentations_et_strat%C3%A9gies_ [...] Permalink : http://lezartsurbains.tipos.be/opac_css/ index.php?lvl=notice_display&id=9300 Exemplaires
Support Localisation Section Disponibilité Catalogue Biblio Saint-Gilles Article Centre de doc. Fardes Exclu du prêt Génération du hip-hop [thèse] / Isabelle Kauffmann / Nantes [France] : Université de Nantes (2007)

Permalink

